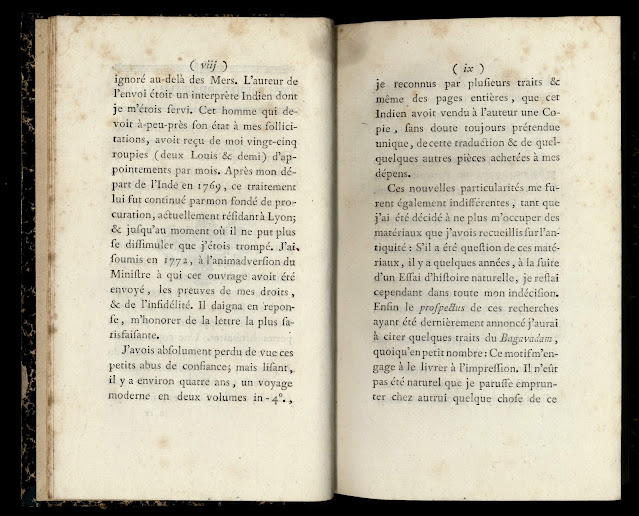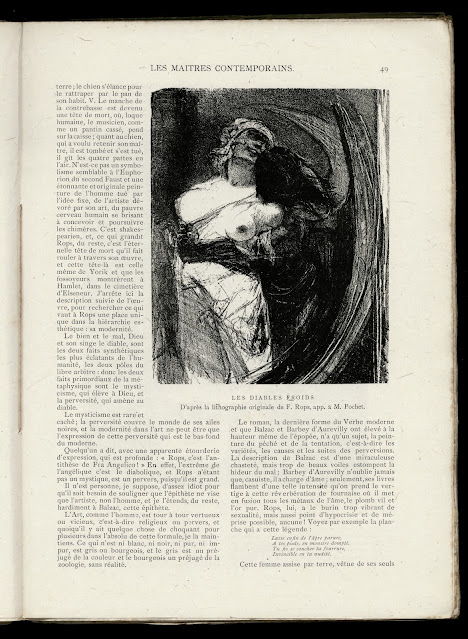[Foucher d'Obsonville] [Maridas Pillai ou Poullé]
Bagavadam ou Doctrine divine, ouvrage indien, canonique : sur l'Etre Suprême, les Dieux, les Géants, les Hommes, les diverses parties de l'Univers, etc.
A Paris, chez la Veuve Tilliard et fils, Clousier, imprimeur du roi, 1788
1 volume in-8 (20,5 x 13,5 cm environ) de LXIV-348-(2). Bien complet de l'Appendice et de l'Avertissement du libraire.
Reliure demi basane maroquinée aubergine (exécutée vers 1870-1880). Quelques frottements à la reliure (peu visibles) et intérieur en bon état (quelques rousseurs peu présentes et une petite mouillure saine et claire dans la marge haute.
Edition originale.
Bagavadam, ou Doctrine divine : sous ce titre évocateur et ambitieux, Foucher d’Obsonville livre au lecteur européen du XVIIIe siècle une traduction pionnière d’un texte fondamental de la tradition hindoue, inspiré du Bhāgavata Purāṇa. Publié à l’aube du tournant orientaliste des Lumières, cet ouvrage s’inscrit dans un moment où l’Europe, avide de savoirs nouveaux, découvre avec fascination les cultures de l’Asie. Dans le sillage des premiers missionnaires, voyageurs et administrateurs coloniaux, une génération d’érudits commence à s’intéresser non seulement aux langues orientales, mais aussi aux textes religieux et philosophiques qui fondent les civilisations de l’Inde. Foucher d’Obsonville, officier au service de la Compagnie française des Indes orientales, incarne cette curiosité éclairée. Formé à la pensée classique, mais ouvert à l’altérité, il s’attache à comprendre les doctrines de l’Inde avec une volonté sincère d’exactitude et de respect. Son Bagavadam, publié en 1788, bien que largement incomplet et erroné en plusieurs endroits, se situe dans la lignée des grandes entreprises orientalistes, comme celles de Friedrich Schlegel, Anquetil-Duperron ou encore la Bhagavad-Gîtâ traduite par Charles Wilkins. Il figure ainsi parmi les toutes premières tentatives françaises de rendre accessible, dans une langue élégante et raisonnée, la richesse symbolique et métaphysique des textes sanskrits. Loin d’être une simple curiosité exotique, cette œuvre témoigne d’un désir profond de comparaison des systèmes de pensée, typique des Lumières tardives, où le dialogue entre les traditions religieuses sert une quête universelle de vérité. Dans un siècle encore marqué par l’eurocentrisme, mais ébranlé par les premières fissures critiques de la pensée coloniale, le Bagavadam se distingue par son ambition intellectuelle : faire connaître à l’Occident une théologie du multiple, une cosmogonie cyclique, une sagesse où l’homme, les dieux et l’univers s’inscrivent dans une interdépendance harmonieuse. Par là même, l’œuvre annonce les grandes synthèses spirituelles du romantisme et de l’orientalisme du XIXe siècle, tout en conservant la rigueur d’un travail philologique de premier plan.
Selon Barbier (I, 377), cet ouvrage a été traduit du sanskrit d'après une version tamoule, et mis en français par un Malabare chrétien, nommé Maridas Poullé (1721-1796). Il n'est pas cité par Foucher d'Obsonville qui semble n'avoir été que l'éditeur.
Le Bhāgavata Purāṇa, ou Śrīmad Bhāgavatam, est l’un des textes sacrés les plus vénérés de l’hindouisme, véritable somme théologique et mythologique en douze livres célébrant la figure divine de Krishna comme manifestation suprême de l’Absolu. Structuré autour du dialogue entre le roi Parīkṣit, condamné à mourir en sept jours, et le sage Śuka, l’ouvrage expose une vision cyclique de l’univers, narre la création des mondes, les avatars de Vishnou, et notamment la vie de Krishna, à la fois espiègle enfant divin, séducteur céleste et guide spirituel. Par son lyrisme, sa richesse narrative et sa profondeur philosophique, le Bhāgavata Purāṇa constitue un pilier de la tradition bhakti (dévotion) et une invitation à la contemplation, à la piété et à la libération intérieure. Ce texte fondamental, transmis et commenté au fil des siècles, demeure une source inépuisable pour qui souhaite comprendre le cœur spirituel de l’Inde. Il faudra attendre les travaux érudits d’Eugène Burnouf au XIXe siècle pour qu’enfin s’esquisse une édition scientifique fondée sur les sources sanskrites authentiques (1840-1847 pour les trois premiers tomes publiés à l'imprimerie royale, 1884 pour le tome IV et 1898 pour le tome V et dernier, ensemble comprenant les 12 livres requis).
"[...] Au-delà de ces mondes & plus bas, l’enfer est placé. Des fleuves de feu, des bêtes féroces, toutes sortes d’armes tranchantes, les ordures les plus infectes, enfin tous les maux y sont avec profusion. Les hommes après leur mort sont conduits devant Yamin, Président de ce lieu d’horreur : Ce Juge juste & équitable ne fait acception de personne ; il est inexorable. Ceux qui dédaignent les règles & les préceptes de piété, seront punis autant d’années qu’il y a de poils sur leurs corps. Les Athées & ceux qui méprisent la Religion, seront jetés sur des monceaux d’armes pointues. Ceux qui outragèrent les personnes en dignité & les Brahmes, seront coupés par morceaux. Les adultères, seront contraints d’embrasser des statues de fer rougies au feu. Ceux qui ne remplissent pas les devoirs de leur état, ou qui abandonnent leurs familles pour courir le pays, seront déchiquetés par des corbeaux à becs de fer. Ceux qui font mal à leur prochain ; ceux qui tuent les animaux, seront jetés dans des cachots infects, pour y souffrir des tourments horribles ; les malheureux qui n’ont pas respecté leurs parents & les Brahmes, seront dans un feu dont les flammes s’élèveront à 10,000 yossiney. Ceux qui ont maltraité les vieillards & les enfants, seront rôtis dans des marmites de fer. Les débauchés qui, sans honte, vivent pendant le jour avec des courtisanes, seront obligés de marcher sur des épines. Les médisants & les calomniateurs seront couchés sur des lits de fer, où ils seront nourris d’ordures. Les avares serviront de pâture aux vers. Ceux qui ont pillé les Brahmes, seront sciés. Les cœurs durs qui par motif d’ostentation, ont tué en sacrifice des vaches & d’autres animaux, seront battus sur une enclume. Ceux qui n’ont pas eu pitié des misérables & des pauvres, seront brûlés avec des tisons de feu. Les faux témoins seront précipités du haut des montagnes. Enfin les corps damnés (formés d'une matière subtile), quoique morcelés par les tourments, se réuniront tout de suite comme du vif argent, & ces malheureux ne mourront point." (extrait pp. 150-152).
Bon exemplaire cet ouvrage peu commun.
VENDU